
Pladoyer pour la danse
Par Yvon Guilcher et Pierre Corbefin
Dans cette deuxième partie, Yvon et Pierre font porter leur réflexion sur l’état de la pratique actuelle de la danse traditionnelle. Et plus précisément sur les conditions de sa transmission. Laquelle, aujourd’hui, s’effectue en priorité par le truchement du bal. Le bal, espace de tous les plaisirs – la sociabilité « rapprochée » qui s’y construit -, comme de tous les dangers, l’initiation hâtive, superficielle, inachevée qui s’y développe et qui fait que la danse qui s’y transmet y perd ce qui en constituait la personnalité esthétique, la signature : sa capacité à rendre compte de la diversité des cultures humaines.
A travers vos propos, on devine une insatisfaction. Que déplorez-vous dans la pratique revivaliste actuelle ?
Yvon. Nous déplorons un malentendu entre la danse traditionnelle et ce qu’on voit faire désormais sous cette appellation. Vouloir dissiper ce malentendu, raconter l’enquête, évoquer les personnes qu’on y a rencontrées, projeter des films ethnographiques, attirer l’attention sur ce qu’ils donnent à voir, c’est certes toucher beaucoup de gens, qui écoutent et regardent passionnément, avides d’en savoir toujours plus ; mais c’est aussi en voir d’autres consulter leur montre ou leur portable et demander : « Quand est-ce qu’on danse ? ». On a envie de leur répondre : « Jamais, si vous vous détournez de tout ce qui peut vous rendre danseurs ». Je pense que pour de tels élèves l’enjeu est seulement de s’approprier le savoir-faire de l’instructeur. Quel qu’il soit. Et ensuite de partager leurs acquis avec d’autres, au sein des consensus revivalistes. Quels qu’ils soient. On voit alors s’installer une pratique mal informée et de faible niveau technique, mais qui a le mérite d’être sécurisante, parce qu’elle est rassembleuse. Pour que ces gens-là attendent et exigent plus, il faut susciter et éduquer en eux une demande qu’ils n’ont pas au départ.
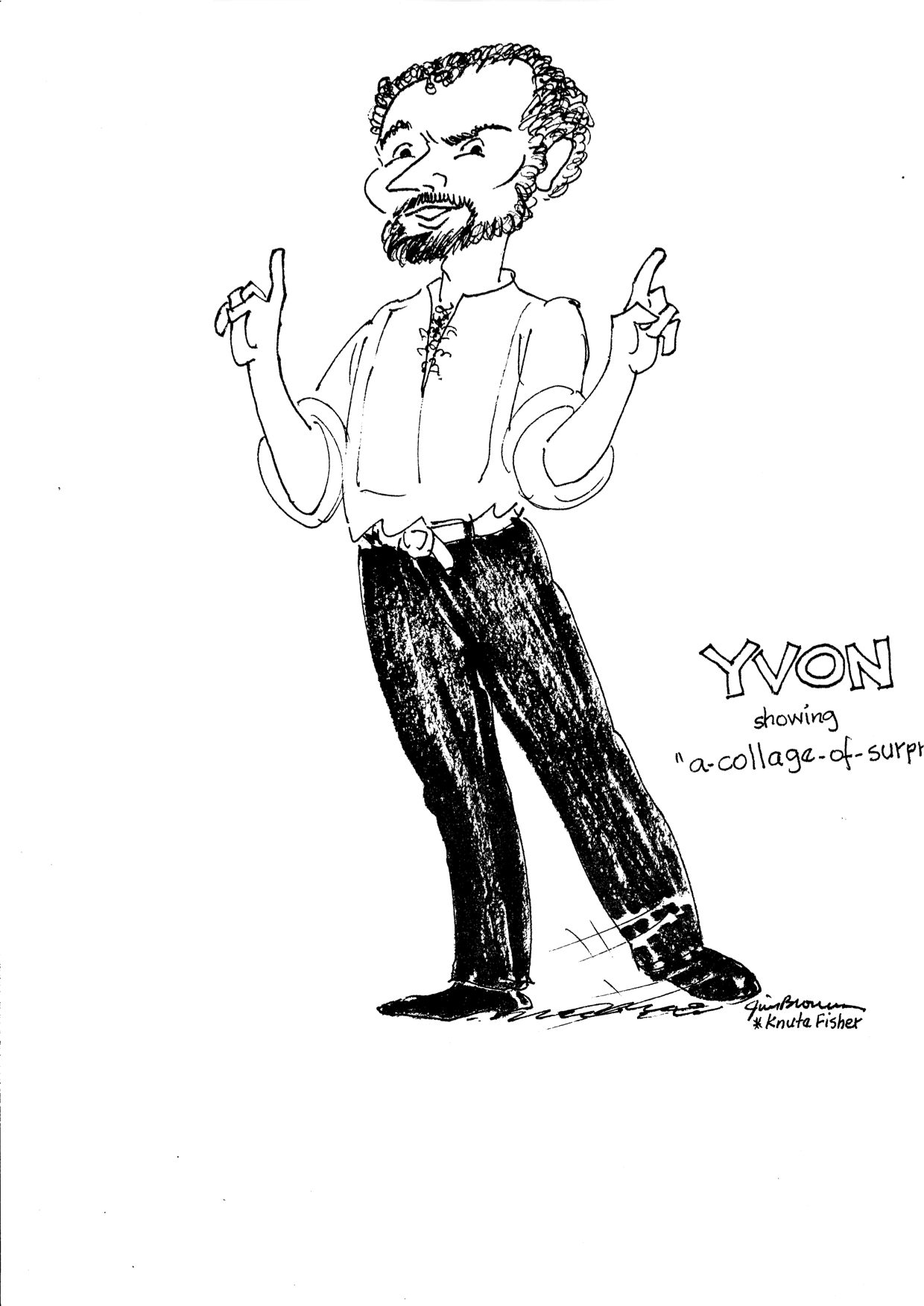
Pierre. Je partage l’agacement d’Yvon. Les impatients en question viennent dans les stages et les ateliers avec un objectif clair et parfois affiché : apprendre le plus vite possible le plus grand nombre de danses possible, au mieux pour aller danser dans les bals, au pire pour retransmettre à leur tour. D’où cette volonté de rentabiliser le temps au maximum, cette tendance à considérer comme encombrant tout ce qui ne relève pas strictement de l’initiation technique de base : les pas, les trajets. Cela fait penser aux offres de certains voyagistes : « Toute l’Italie en quarante-huit heures ! ». Pour les formateurs, qui ont entretenu avec les danseurs dont ils s’efforcent de transmettre le savoir des relations fondées sur le respect et l’estime, voire sur une profonde affection, ce type de comportement fondé lui sur l’irrespect, même s’il reste minoritaire, a quelque chose d’humiliant. Les conséquences de cette désinvolture sont visibles : la qualité de la danse ne cesse de se dégrader. Non seulement parce qu’elle s’écarte de toute référence esthétique, mais surtout parce qu’elle n’en propose pas d’autres.
Donc, à la fois un manque d’authenticité et un manque de qualité ?
Yvon. La question est de savoir si l'une peut aller sans l'autre. Car le problème, c’est que la qualité de la danse traditionnelle est d’abord une qualité traditionnelle de la danse. Soumettre une bourrée ou un branle d’Ossau à une esthétique de ballet classique ou contemporain, c’est certes leur conférer une qualité, celle du ballet. Mais ce n’est justement pas de celle-là qu'on est en quête. Vous allez me dire : pourquoi pas ? Métissons ! Une scottish à saveur de salsa, ce n’est pas désagréable ! Certes ! Mais ça nous supprime la scottish, sans pour autant enrichir la salsa. Et c’est pire pour les répertoires traditionnels : bourrées, dans tro, branles d’Ossau, rondeaux, on les évacue pour mettre autre chose à la place, faute d’avoir compris ce qu’ils proposent par eux-mêmes. Alors si la danse traditionnelle n’a plus sa qualité à elle et si une autre que la sienne revient à la supprimer, il reste quoi ? Une dégradation de ses répertoires vers une gesticulation amnésique.
Pierre. A ce propos me revient à l’esprit la prestation conçue et emmenée de main de maître par Jean-François Miniot, « Pas de danseur… pas de danse », que j’ai eu le vif plaisir de découvrir en 2013, à Saint-Gervais d’Auvergne. Jean-François y fait plusieurs démonstrations : en premier lieu celle de ses compétences de danseur, parce qu’il s’engage dans la danse avec son corps tout entier, condition sine qua non de tout exercice chorégraphique. Ensuite il donne à voir sur une famille de danse – les avant-deux du Poitou – , seul ou avec le concours de certain(e)s de ses ami(e)s, à la fois ce que les avant-deux ont en commun : l’accent gestuel spécifique à ce pays de danse-là, mais aussi, sur un même schéma, la variété tout à fait réjouissante des interprétations qu’il a pu relever auprès des danseurs qu’il a côtoyés lors de ses enquêtes. Et puis, autre performance, ô combien précieuse elle aussi, et bienvenue, le groupe de musiciens dont il s’est attaché la collaboration – Maxime Chevrier au premier chef (partie prenante dans la conception du spectacle) - apporte la preuve qu’on peut être en osmose totale avec les danseurs sans abandonner pour autant l‘extrême qualité de la prestation musicale produite et le bonheur de jouer qui en découle. Je me suis dit : voilà l’exemple de démonstration dont nous avons besoin aujourd’hui. Elle donne à voir, et superbement, l’essentiel de ce qui nous est nécessaire. Tant aux danseurs qu’aux musiciens.
Yvon. Le projet de Miniot et son équipe a une visée épistémologique. Il illustre une réflexion à la fois informée et critique sur « la tradition » et ce que nous en faisons. Notamment sur cette question d’authenticité, notion problématique en soi et à la limite facultative. Sauf qu’elle traverse en filigrane tout le discours revivaliste : il y aurait un rondeau de Garein, un autre de Luglon, différents de ceux d’Aire sur Adour, de Saint-Yaguen ou de Souprosse ; la « gavotte » de Plouyé ne serait pas celle de Scrignac, il en existerait une propre à Poullaouen, une autre à Châteauneuf ou Spezet ; en dro aurait un pas latéral avec « enroulé-déroulé » des bras, il n’y aurait pas de mouvements de bras dans l’hanter-dro, ni de tamm-kreiz en kost er hoëd, la gavotte de l’Aven s’attaquerait pointe tendue, etc. etc. Tout cela est erroné. Mais ne s’en réclame pas moins d’une information ethnographique. Quelle autre référence aurait-on pour postuler de telles différences géographiques ? Quelle légitimité aurait notre dogmatisme ? Or il y a dogmatisme. Alors qu’est-ce qui le fonde ?
Pierre. Je crois que quand les danseurs, formateurs compris, rattachent une danse à un lieu déterminé, ils obéissent d’abord à une nécessité : identifier la danse concernée. Face à la multiplication des répertoires, comment s’y retrouver si les danses n’ont pas un label d’origine, à l’instar de tous les autres produits du marché (saucisse de Toulouse, de Morteau, de Strasbourg, etc.) ? Les choses qui ne sont pas identifiables n’existent pas, m’a dit un jour Hugues Rivière (je le cite de mémoire), quand j’ai cessé de rattacher les schémas rythmiques des rondeaux en chaîne à des lieux précis, et ceci suite à une discussion avec Yvon sur le sujet. J’ai le sentiment que ce besoin d’identification témoigne aussi de la représentation qu’ont les danseurs d’aujourd’hui de la danse traditionnelle et du monde dont elle est issue. Un ailleurs mystérieux et très mythifié, où dans tel village on dansait telle danse de telle façon et que c’était génial. Le Berry du Grand Meaulnes, en quelque sorte.
Yvon. Oui, je suis d’accord. J’ajouterai juste ceci : si tant est que le Grand Meaulnes soit berrichon, la berrichonnitude de ses chromosomes m‘intéresse moins que celle de sa bourrée. Dans le cas où sa bourrée relèverait d’un ailleurs mythifié étranger à la fois au Berry et à sa danse (pas de polka, tombés remplacés par des surrections, inclinaisons du buste, balancement des bras, bourrées à deux temps sur deux lignes affrontées), le dépaysement n’apporterait rien. L’authenticité, c’est d’abord que la bourrée en soit une. Le problème, c’est la difficulté des gens à se représenter ce qu’à pu être une culture populaire. Ils sont éduqués à tout autre chose.
_modifié-1.jpg)
Yvon Guilcher ( Photo Dominique Lemaire -Laon 1980)
Mais cette démission du revivalisme n’est-elle pas présente déjà aux débuts du mouvement folk, dans lequel vous vous êtes tous deux impliqués ?
Pierre. A mon avis, une des causes du malentendu dont parle Yvon est à rechercher dans le décalage entre les motivations des premiers acteurs du mouvement et celles des publics actuels. Nous recherchions tout à la fois des outils de reconquête d’une culture jusque-là méprisée par l’histoire officielle ; des moyens de nous réapproprier directement, empiriquement, des pratiques musicales, vocales, chorégraphiques jusque -là soumises à des apprentissages formels voire élitistes ; et cette sociabilité, anéantie par la société marchande, dont la société traditionnelle nous semblait prodigue. Aujourd’hui ces répertoires que nous nous sommes employés à réintroduire sont devenus de simples marchandises dont l’abondance grandissante est une incitation aux comportements consuméristes. Les impatients qui consultent leur montre sont sans doute minoritaires, mais leur impatience est celle du consommateur moyen, tel que le monde d’aujourd’hui en produit de façon massive. Boulimie qui s’accompagne d’une faible curiosité et d’une absence d’esprit critique. Même si la danse survit à l’uniformisation en marche, rien n’aura survécu de ce qui en fait l’intérêt, sa capacité à rendre compte de la diversité des cultures humaine. Pour éviter ce naufrage, il faut mettre la danse à sa place exacte : au centre. La danse traditionnelle n’est pas un jouet. S’astreindre à l’aborder avec humilité, avec ténacité et avec la volonté de se doter des connaissances qui en assureront la maîtrise n’est, qui plus est, en rien incompatible avec la recherche du plaisir. Celui-ci sera d’autant plus fort que la maîtrise du sujet sera grande. Ni avec la liberté d’expression, sachant qu’au terme de l’apprentissage – est-il d’ailleurs jamais achevé ? - aucun danseur ne sera privé de son expressivité personnelle. Pour ma part, j’accepte de plus ou moins bonne grâce la revendication à la mode du plaisir immédiat, mais je continuerai à me battre pour promouvoir l’idée que la danse traditionnelle mérite un autre traitement, une autre approche, une autre considération que ce qui n’est finalement, dans le comportement de certains, qu’une forme d’irrespect.
Yvon ?
Yvon. Au cours des années 1970, nous avons misé sur deux approches distinctes, qu’on estimait complémentaires : le bal d’une part ; le stage d’autre part. Le bal supposait moins un enseignement qu’une animation, destinée à donner envie d’aller plus loin. On y introduisait des répertoires n’exigeant pas de savoir-faire particuliers (mixers, branles, etc.). Le stage proposait un travail plus sérieux. Bref, le bal était là pour apprendre des danses aux gens, le stage pour leur apprendre à danser. Mais, en aval il s’est passé deux choses : d’abord il y a vite eu une coupure entre le public des bals et celui des stages, voire parfois une animosité réciproque. Le stage était décrété « élitiste » par les uns, le bal de trop faible niveau par les autres. De sorte que chacune des deux approches s’est trouvé un public distinct. Ensuite, les répertoires travaillés en stage ont commencé de faire irruption dans les bals, introduits hors de tout contrôle par des gens qui les tenaient de seconde main et ne les dominaient pas, phénomène qui s’était déjà produit pour le fest noz dix ans plus tôt. A l’heure actuelle, le bal est devenu l’unique lieu d’apprentissage pour la plupart des danseurs. Ce qu’on y voit ne mérite plus vraiment le nom de danse. On diffuse des répertoires ; on n’apprend pas aux gens à les danser. Le résultat est pauvre. On s’ennuie à regarder ça. Il y manque la qualité qui donnerait du plaisir.

Branle d'Ossau à Brétigny sur Orge ( Photo D. Lespiac)
Pierre. Je partage cette impression. Aujourd’hui la transmission de la danse consiste essentiellement à s’approprier des danses issues de répertoires de toute origine. On fait du suédois, du breton, etc. Dans les bals, le lieu où s’effectue majoritairement la transmission, on s’initie par imitation, en butinant d’un répertoire à l’autre, en n’en retenant que la surface : le pas, le rythme, les trajets. Dans les stages et les ateliers, c’est souvent à cette approche rudimentaire que se limite l’ambition du formateur. Convaincu qu’il est de munir ses élèves de l’essentiel. Ces deux types de transmission – je me refuse à employer à leur propos le terme d’apprentissage – qui offrent beaucoup de similitudes, produisent le même résultat : une uniformisation par le bas du niveau de la danse. Pourquoi ? Parce que dans les deux cas, l’essentiel est négligé. Le danseur n’a pas – ou trop peu - été instruit de deux aspects essentiels : le corps d’une part ; l’accent, l’intonation du geste de l’autre. Le corps, parce que la danse, quelle qu’elle soit, engage le corps tout entier. Apprendre une danse par le seul truchement d’un pas et d’un trajet n’est en aucun cas suffisant. Réunir son corps et l’engager d’une seule pièce dans l’espace, préalable indispensable à toute aventure chorégraphique, exige une prise de conscience, un apprentissage à part entière et à long terme. Et puis, il y a cette particularité de la danse « trad », tellement centrale celle-là : sa signature, la qualité sui generis du geste, laquelle diffère d’une culture à l’autre. La gestuelle de la bourrée des Combrailles n’est pas celle de la polka a saltini du nord-ouest de l’Italie, pour ne retenir qu’un exemple parmi d’autres. Et même si nous sommes conscients de ne pouvoir atteindre cette singularité du mouvement telle que nous avons pu l’observer chez les danseurs qui sont nos modèles, nous nous devons de prendre cet aspect en considération. Parce que lui seul est capable d’exprimer l’esthétique – les esthétiques – propre (s) aux danses traditionnelles. J’ajoute que cette recherche n’aura quelque chance d’aboutir que si le point précédent est pris en compte : la maîtrise du corps. Danser, ça ne se réduit pas à mémoriser où et quand on doit poser le pied gauche, puis le droit, etc. La danse, c’est comme un langage parlé. Enumérer, aligner des syllabes, ça ne suffit pas. Il faut savoir les prononcer, les articuler. Chercher les sonorités, la juste intonation. De même qu’en danse, il faut savoir avec quelle qualité de mouvement on va d’un appui à l’autre.

Danseurs ( Photo Véronique Chochon)
Yvon. Faute de quoi on a droit à des « tournantes des Grandes Poteries » sans pas de bourrée, à des contredanses marchées comme derrière un corbillard, à des valses qui ne tournent pas, à des rondeaux gambadeurs ou tétanisés, etc. ; toutes choses que chacun est impatient de retransmettre. Et là, ce qui est en cause, indépendamment de toute authenticité, c’est la qualité de la danse. En la refusant, nous discréditons ce que nous prétendons aimer. Le ballet classique a une qualité que personne ne nie ; les claquettes américaines aussi ; le hip-hop aussi. La danse traditionnelle que nous donnons à voir n’en a aucune. Or elle en avait une dans son milieu d’origine. Parler de qualité du mouvement, c’est rencontrer de l’incompréhension chez la plupart des gens. Alors on voit se généraliser partout la danse moche, le danser faux, la maldanse. Remédier à une telle situation est mission quasi impossible. D’abord parce qu’elle bénéficie d’un consensus général ; ensuite parce que les milieux traditionnels ne sont plus là pour faire le corrigé ; et que par suite le « trad » est le seul domaine où n’importe qui peut se déclarer compétent, s’assurant une audience à bon compte ; enfin parce que la danse traditionnelle a perdu ses contextes : on la parque dans une réserve, le bal, qui est devenu le lieu de l’antidanse. Et le pire c’est que c’est nous qui l’avons inventé, le bal folk.
Pierre. Oui, le bal est devenu un phénomène face au succès duquel j’éprouve pour ma part des sentiments opposés. D’un côté je me réjouis de voir se développer une formule où les participants –danseurs, musiciens, chanteurs – sont les acteurs directs de leur propre plaisir. Un espace qui par essence génère de la sociabilité. Dans une société qui n’en produit plus, la sociabilité du bal a un pouvoir de séduction et un rôle sanitaire tout à fait réjouissants. Et de l’autre côté le bal, parce qu’il est irremplaçable, j’enrage qu’il soit devenu ce que souligne Yvon, une machine à fabriquer du « danser faux ». Au moins pour les danseurs qui se satisfont de l’initiation indigente qu’on y reçoit.



